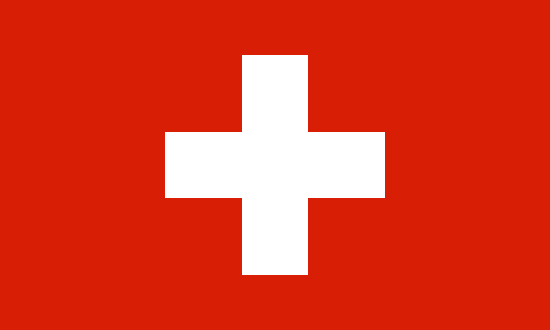
Suisse
Casque Modèle 18/63
Fiche
- Dénomination : modèle d'ordonnance 1918 modification année 1963.
- Pays d'origine : Suisse.
- Destiné à une utilisation générale.
- Coiffe en cuir constituée de 3 pattes.
- Jugulaire simple en cuir et fixation par crochet.
- Variante antérieure : modèle 18 et modèle 18/40.
- Camouflage par couvre-casque.
- Fabriqué à partir de 1962.
- Distribué à partir de 1963.
- Période d'utilisation : années 60 à fin des années 1970.
- Matériaux : acier nickelé de 1,5 mm.
- Taille : unique ?
- Poids : 1170 gr.
- Couleur : gris anthracite rugueux.

Casque d'ordonnance Modèle 18 modifié 63.
Historique
|
Après 40 ans de service et une modification majeure apparue en 1940, le casque d'ordonnance modèle 18 subit une dernière évolution au début des années 60. L'apparence générale reste identique, mais une fois de plus, la coque subit un léger changement de forme au niveau de la visière et reçoit une nouvelle coiffe dont les coussinets sont issus du modèle adopté pour le casque modèle 48/62. Des essais ont été menés, principalement sur la coiffe et la jugulaire, afin d'offrir une meilleure stabilité, mais aucun ne sera retenu, le changement sera au final mineur et ne résoudra pas les problèmes rencontrés depuis son adoption en 1918. Au lendemain de la guerre, l'intendance, forte de l'enseignement de la seconde guerre mondiale, décida d'adopter un casque plus adapté pour ses troupes aéroportées, mécanisées et motocyclistes. Pour cela, la Suisse acheta le 23 février 1948 13 377 casques Mark II AT, DR et RAC, à la société "Oversea Trading Compagny" de Anvers en Belgique (société qui fut chargée de liquider les casques de parachutistes Britanniques Mark I AT et Mark II AT) au prix de 3 Francs de l'époque pour une demi-douzaine de casque. Cette dernière mouture du casque, dénommée modèle d'ordonnance 18 modifié 1963 (bien que nous ayons trouvé des coiffes datées de 1962), ne restera pas en service aussi longtemps que ses versions précédentes. En effet dès le milieu des années 60, sont effectués des essais en vue de l'adoption d'un nouveau casque, ceci expliquant sans doute le choix d'une modification mineure pour le modèle 18. Ce nouveau casque, le modèle 71, distribué à partir de 1974, remplacera très rapidement les modèles 18 qui seront retirés du service sans être recyclés ; dès la fin des années 1970, il n'y en a plus en service dans l'armée. Resté en service pendant presque 50 ans, on peut considérer que ce casque détient le record absolu de longévité. Conçu à l'époque de l'apparition des premiers casques, fortement inspiré du "Stahlhelm" allemand, il ne sera finalement définitivement détrôné que par la dernière série de casques métalliques, qui seront eux-mêmes très rapidement remplacés par les casques kevlar que nous connaissons aujourd'hui. Pour fermer la boucle, nous pourrions préciser que ces casques modernes ne sont pas sans rappeler à nouveau la forme des "Stahlhelm" de conception allemande. |
 Casque modèle 18/40. |





Constitution
La coque :
 Vue de face. |
 Vue de côté. |
 Vue de dessus. |
 Vue arrière. |
 Vue de côté. |
La coque du casque modèle 18/63 est fabriquée d'une seule pièce par emboutissage d'une feuille d'acier au nickel de 1,15 millimètre d'épaisseur. Nous n'avons pas à ce jour rencontré d'exemplaire de taille B. La coque subit une modification au niveau de la visière, plus proche à nouveau de la forme initiale du modèle 18, la mesure par l'arrière entre les deux décrochements latéraux fait à nouveau plus ou moins 52 cm, mais la pente est nettement plus accentuée, de sorte que la vision se trouve très bien dégagée sur les côtés. La visière, pratiquement horizontale dans son avancée affecte définitivement l'apparence d'une casquette. |
Pour mémoire et comparaison, voici les trois formes de coques. La différence avec le casque modèle 63 est évidente, elle est plus subtile entre le Mle 18 et le Mle 40, mais néanmoins visible.
 Modèle 18. |
 Modèle 40. |
 Modèle 63. |
Il subsite sur le casque modèle 18/63 des différences de cotes assez importantes entre les différentes fabrications.
 Bord extérieur.  Bord intérieur. |
 Rivet d'aération extérieur.  Rivet d'aération intérieur. |
Une bordure est emboutie sur toute la périphérie du casque à 5 mm du bord. Elle forme, côté extérieur, un bourrelet de section semi-circulaire de 5 mm de diamètre et côté intérieur, une rigole dans laquelle le rebord restant est replié, venant ainsi en continuité avec l'intérieur du casque. |
 Vue des 6 agrafes et de leurs supports. |
  Support d'agrafe. |
 Agrafe. |
 Agrafe glissée dans son support. |
Six passants métalliques, destinés à retenir les agrafes de fixation du cerclage de la coiffe, sont soudés sur la périphérie intérieure de la coque. Chaque passant est constitué par une plaque de tôle de dimension 20 x 15 mm, pliée en U, dont les extrémités sont rabattues vers l'extérieur pour être soudées électriquement à la coque, chacune par deux points. Une agrafe de coiffe est ensuite glissée dans le passage ainsi ménagé.
Les agrafes, qui conservent la même forme que sur les modèles précédents, sont donc désormais amovibles. Elles sont toutes identiques et mesurent 60 x 11 mm. Leurs extrémités sont biseautées symétriquement à 15 mm, de manière à se juxtaposer, sans se superposer, une fois rabattues sur le bandeau de coiffe. Les pointes sont arrondies pour éviter d'être blessantes.
A noter que l'on trouve le même dispositif de maintient sur les coques modèle 40 à partir de 1955. On trouve aussi des coques modèle 40 avec la nouvelle coiffe, il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse de coques de stock qui n'avaient jamais été montées avant l'introduction de cette nouvelle coiffe vers 1960 .

Exemple de coque modèle 18/40 (à gauche) montée comme le 18/63 (à droite).
Teintes et marquages.
Les teintes utilisées varient très peu, la protection civile peint toujours ces casques en jaune et les pompiers en noir. Pour l'armée, l'intérieur du casque est désormais peint en gris et l'extérieur en gris anthracite mêlé à de la sciure.
 Armée : Teinte extérieure. |
 Armée : Teinte intérieure. |
 Noir Pompier. |
 Jaune Protection Civile. |
 |
 |
Le casque modèle 18/63 ne comporte plus aucun marquage de taille ou de numéro de série. Les casques qui présentent encore un tel marquage blanc sont des modèles 43 dont la coiffe a été changée, ils ont le fond noir et pas gris (ainsi que des agrafes de coiffe soudées). |
La coiffe :
 Coiffe en place. |
 Coiffe face interne. |
 Coiffe face externe. |
La coiffe modèle 18/63 se compose de trois pièces de cuir identiques de 14,5 par 11,5 cm, réparties à égale distance sur un cerclage. Chacune est taillée dans du cuir de vache de teinte fauve clair. La base ne se scinde plus en deux parties, mais s'affine désormais en une seule partie, qui se replie sur elle-même sur 2,5 cm pour le passage du lacet assurant le réglage de la profondeur.
Ces pièces sont identiques à celles déja adoptées pour la coiffe du casque modèle 48/62. Le concept sera repris pour la coiffe du casque modèle 71 (bien que de dimension réduite).
 Patte de coiffe : Partie en contact de la tête. |
 Détail couture. |
 Patte de coiffe : Partie rembourrée. |
Le côté large de la patte est cousue sur toute sa longueur sur le cerclage, cinq points sont cousues sur la seconde ligne. Au niveau du bord du cerclage, la patte est incisée à deux reprise pour le passage des agrafes. L'extrémité fine est repliée sur elle-même puis cousue sur 3 lignes, l'espace ainsi crée, destiné au lacet de réglage est très ample.
Sur le revers de chaque patte est cousue une poche rectangulaire en tissus, ouverte sur l'un des côtés, ainsi que deux demi lacets.
|
Le compartiment contient une ou plusieurs bandes de feutre de différentes épaisseurs. Ceci assurant le réglage du tour de tête. Le maintien du rembourrage est assuré par un petit lacet de même nature que celui servant au réglage en profondeur. |
 Compartiment de rembourrage. |
 Rembourrage en feutre. |
 Agrafe rabattue sur le cerclage. |
 Agrafes en place. |
 Baleines. |
Le cerclage de 20 mm de large, est réalisé à partir d'une bande de toile grise pliée en deux parcourue par trois coutures longitudinales. Le triple fourreau ainsi réalisé, renferme trois baleines en matière composite. Cet ensemble, cintré à la forme exacte de l'intérieur du casque, reste ouvert à l'arrière.
Les agrafes, au nombre de 6 (à raison de deux par patte de coiffe), passent pour leur partie suppérieure à travers l'espace découpé dans la coiffe pour venir se rabattre sur l'arceau.
 Lacet de réglage en profondeur en place. |
 Lacets et embout chauffé. |
  Différents lacets. |
Le lacet en tissu tressé qui peut être de nature différente, mesure environ 60 cm de long sur 7 mm de large. On peut trouver un lacet plat identique à celui qui ferme les compartiments de rembourrage ou un lacet plus épais qui est chauffé aux extrémités pour éviter son effilochement.
Il se noue sur lui-même après être passé dans les trois éléments de la coiffe, en le serrant plus ou moins, on obtient un réglage de la profondeur de la coiffe.
Marquages.
 Indiquation de la taille "A". |
Le revers de la coiffe est marqué de différents tampons, en général noirs ou bleus, identifiants le fabricant (poinçon du sellier) et comportant souvent l'année de production sur 2 ou 4 chiffres. La première année que nous avons trouvée sur une coiffe modèle 63 est 1962, elle sera encore produite pour les casques de la Protection Civile jusqu'à l'abandon complet de ce type de casque, l'armée ayant terminée son remplacement par le modèle 71 débuté en 1974, dès la fin des années 70. Enfin, il faut sans doute considérer que l'adoption de cette coiffe pour le modèle 18 relève plus de l'harmonisation industrielle, liée à l'adoption de cette nouvelle forme de patte pour le casque modèle 48/62, que de la réelle volonté de la modifier. |
 Paul Stalder 1962 - Bern. |
 Walter Iseil - Bigien. |
 F. Burger 1969 - Blumenstein (Taille A). |
 F.B.B. 1976. |
 Glaus 1980 (Sur un casque PC jaune). |
La jugulaire :
|
La jugulaire est toujours du modèle adopté le 22 octobre 1930 pour le casque modèle 18. Cette jugulaire restera identique jusqu'à la fin de la production du casque au milieu des années 70. |
 Jugulaire : Partie gauche. |
 Jugulaire : Montage de la partie gauche. |
Côté gauche, la jugulaire est constituée d'une lanière de cuir 41 cm pour 2 cm de large. Un côté retient le mousqueton qui assure la fermeture alors que l'autre extrémité est percée de cinq boutonnières, la première étant à 15 mm du bord. Après un espace de 45 mm, les quatre autres s'échelonnent tous les 25 mm. Ce dispositif permet un premier réglage fixe de la longueur de la jugulaire. |
 Boucle coulissante. |
 Bouton amovible. |
 Mousqueton. |
Le mousqueton se compose d'une lame d'acier de 15 mm de large et de 60 mm de long, dont le bout replié sur 12 mm forme un crochet plat. Une deuxième lame de 39 mm cintrée en "S", fait office de ressort. Ces lames sont fixées de part et d'autre du bout de la jugulaire, qu'elles recouvrent sur 10 mm. Elles y sont maintenues par deux rivets en aluminium légèrement bombés. Ce mousqueton est le plus souvent peint en vert.
Les pontets sont formés par une tige métallique, enchapée de chaque côté, par une fourche fixée entre la coiffe et les agrafes de la coque (à la seconde et cinquième agrafe en partant de l'arrière du casque).
Côté gauche il s'agit d'une simple tige droite.
 Pontet gauche seul. |
 Pontet monté sur l'agrafe. |
 Monté en place avec la jugulaire. |
Côté droit c'est une pièce métallique d'un seul tenant, destinée à recevoir le mousqueton. Composé d'un fil d'acier de 2 mm de diamètre replié sur lui-même. Le haut de la pliure est élargi en rectangle de 20 x 10 mm formant une boucle dans laquelle viendra s'accrocher le mousqueton. Les deux extrémités du fil sont pliées en opposition, à angle droit, et viennent prendre la place du pontet droit dans son enchapure. Ce dispositif une fois en place a une longueur hors tout de 50 mm. Le mousqueton vient se clipser sur la tige métallique.
 Pontet droit seul. |
 Pontet verso. |
 Pontet en place. |
 Pontet en place, mousqueton fermé. |

Jugulaire complette avec les deux pontets.
Les accessoires :
Bande de manœuvre.Il existe pour ce casque une bande de manœuvre. Elle est en coton tressé blanc et n'existe que dans cette teinte. |
 Bande de manœuvre - Crochet. |
 Bande de manœuvre - Crochet. |
 Bande de manœuvre. |
 Bande de manœuvre montée sur le casque. |



Manœuvres dans les années 60 - Canotage, franchissement.
Identification.Par nécessité d'identifier l'appartenance du matériel, apparaît dès le début des années 50, une pastille en plastique de 24 mm de diamètre, percée d'un trou de 2 mm près du bord, destiné au passage d'un fil permettant la fixation à la coiffe. La ficelle est torsadée en même temps qu'un fil de cuivre. |
  |
Le camouflage additionnel :
 |
Essais de jugulaires et coiffes
Le problème de mauvaise tenue sur la tête du modèle 18 depuis ses débuts ainsi que l'inconfort de sa coiffe n'a jamais été corrigé. Néanmoins des essais furent effectués dans les arsenaux. Aucun ne fut retenu et la dernière mouture du casque sera adoptée sans changement significatif.
Adaptation de la jugulaire du casque modèle 48 :
Le premier essai, qui tient plus du simple bricolage que d'une réelle modification, consiste en l'adaptation de la jugulaire en Y du modèle 48. Un second pontet, identique à celui déjà utilisé sur le casque est ajouté sur les deux agrafes arrière, celle qui présentait l'anneau de fixation du mousqueton est aussi changée. Cette adaptation n'apporte rien du point de vue de la coiffe mais donne enfin une bonne stabilité sur la tête.


Adaptation de la jugulaire d'un modèle 48 sur un casque modèle 40/43.

Nouvelle coiffe :
Cette seconde tentative dénote une étude plus poussée. Le principe de la jugulaire en Y qui a fait ses preuves est conservé. La coiffe quant à elle est maintenant aussi directement inspirée de celle du modèle 48. Un quatrième coussinet apparaît, ce qui rend le port plus confortable, ils sont de la forme adoptée pour le modèle 48 et sont fixés sur un cerclage métallique (aluminium) qui est lui-même solidarisé avec la coque par quatre rivets. Ce cerclage est spécifique à cette étude.


Adaptation de la jugulaire et de la coiffe d'un modèle 48 sur un casque modèle 40/43.
 Vue avant droite. |
 Vue arrière droite. |
 Demi-jugulaire droite. |
 Vue avant gauche. |
 Vue arrière gauche. |
 Demi-jugulaire gauche. |
La jugulaire est fixée à l'avant par deux pontets solidaires du cerclage et à l'arrière sur une pièce identique à celle que l'on trouve aussi sur le modèle 48 et qui est fixée par deux rivets.
L'ensemble des rivets est visible à l'extérieur de la coque.
- Quatre rivets pour la fixation du cerclage, les deux rivets avant retiennent aussi les pontets avant.
- Quatre rivets pour les deux pontets arrière.
 Détail rivets. |
 Fixation jugulaire avant. |
 Fixation jugulaire arrière. |
Les pattes de coiffes sont fixées au cerclage chacune par trois rivets. Pour les pattes avant et arrière, une pièce en carton est intercalée, sans doute pour adoucir le contact avec le cerclage. Une plaque en aluminium assure la bonne tenue de l'ensemble.
 Fixation des coussinets latéraux sur le cerclage. |
 Fixation des coussinet avant et arrière sur le cerclage. Remarquer la pièce de protection supplémentaire. |
Enfin un tampon en mousse, toujours identique à celui du modèle 48) est collé au fond de la bombe.
 Tampon amortisseur. |
 Rivet de fixation du cerclage à la coque. |

Une utilisation particulière : La NNSC
Casque du type 18/63, utilisé à partir des années 60, par les membres de la mission d’observateurs en Corée NNSC. (Neutral Nations Supervisory Commission)
 Coté gauche. |
 Coté droit. |
 Arrière. |
 Intérieur. |
Le casque est entièrement blanc et garni des deux côtés de l'emblème de la mission (quatre couleurs représentant les quatre Etats neutres membres de la mission).
Inscription NNSC en anglais et en coréen. Les emblèmes sont appliqués par décalcomanie. Le brassard quant à lui, précise la nationalité du membre ainsi que ses nom et grade.
Le patch d'uniforme est différent pour chaque pays.
 Brassard Suédois. |
 Patch. |
La NNSC : Les parties du Nord ont proposé la Pologne et la Tchécoslovaquie ; le Sud a désigné la Suède et la Suisse.
Le 7 juillet 1953, le Conseil fédéral autorisa le Département militaire à préparer l’envoi de militaires suisses armés en Corée pour appuyer les deux commissions instituées par l’Accord d’armistice : NNRC (Commission des nations neutres pour le rapatriement des prisonniers de guerre) et NNSC (Commission des nations neutres pour la surveillance de l’armistice). Cette décision marqua pour la Suisse la naissance de la promotion militaire de la paix.
La NNRC a été dissoute le 21 février 1954. (Au 22 janvier 1954, tous les prisonniers de guerre sont libérés : 75 823 Nord-coréens et 6670 Chinois retournent au Nord, 8321 Sud-coréens et 5123 hommes des forces des pays membres du Commandement des Nations Unies (UNC) regagnent le Sud).
La NNSC dans partie sud est toujours active à ce jour (2022).
Autres exemples


Casque modèle 40/43 équipé de la coiffe modèle 62.



Casque modèle 18/63 des soldats du feu. Ces militaires officient dans les arsenaux, les écoles et les aéroports.



Casque attribué au corps des pompiers de la ville de Villigen, canton d'Aargau.


Casque modèle 40/43 de pompier Fédéral, équipé de la coiffe modèle 62.


Casque modèle 40/43 de la police de Genève, équipé de la coiffe modèle 62.


Casque modèle 18/63 jaune de la Protection Civile (avec un insigne de grade).



Casques modèle 18/63 jaune de la Protection Civile et détail des agrafes.


Casque modèle 18/63 gris/vert vraissemblablement de la police. Remarquer le trou pour la fixation d'un attribut.